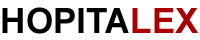Investissements immobiliers des établissements de santé : l'IGAS prône le renforcement du pilotage
Le rapport de l'IGAS se penche sur le pilotage des investissements immobiliers des établissements de santé dans le cadre du plan Ségur.
Lancé en 2021, ce plan vise à moderniser l’offre de soins avec une enveloppe de 7,5 milliards d’euros, majoritairement gérée par les Agences Régionales de Santé (ARS). Cependant, trois ans après, son déploiement est ralenti par la maturité hétérogène des projets et des contraintes financières accrues, notamment en raison de l’inflation et de la hausse des coûts de construction.
L’évaluation du plan Ségur souligne la nécessité de simplifier et de sécuriser les procédures d’instruction des projets immobiliers hospitaliers. Aujourd’hui, l’instruction des projets est répartie entre les niveaux régional et national en fonction de leur coût, avec un seuil fixé à 150 millions d’euros pour une évaluation nationale. Toutefois, ce critère purement financier ne suffit pas à identifier les projets les plus complexes ou critiques. Le rapport recommande donc de revoir ce seuil et d’introduire une analyse de la « criticité » des projets, en tenant compte de plusieurs facteurs comme la soutenabilité financière, la complexité technique et l’impact sur l’offre de soins. Ainsi, seuls les projets supérieurs à 200 millions d’euros seraient systématiquement instruits au niveau national, tandis que ceux compris entre 100 et 200 millions d’euros seraient évalués au cas par cas en fonction de leur complexité. Le rapport note également que seulement 37% des projets de plus de 20 millions d'euros présentaient un programme technique détaillé validé à la fin du premier semestre 2024.
Un autre axe d’amélioration concerne la structuration de l’expertise nationale. L’IGAS constate que le Conseil scientifique de l’investissement en santé (CSIS), créé pour accompagner l’instruction des projets, a joué un rôle positif mais souffre d’un manque de ressources pérennes. Pour remédier à cela, le rapport préconise d’intégrer les missions du CSIS au sein de l’Agence nationale d’appui à la performance (ANAP), qui dispose déjà d’outils et d’expertises dans la gestion des investissements hospitaliers. Ce regroupement permettrait de renforcer la capacité d’analyse des projets, de centraliser les bonnes pratiques et d’apporter un soutien accru aux établissements. Néanmoins, les principaux intéressés que sont les hospitaliers sont fermement opposés à ce qu'ils qualifient de “démantèlement”. Le rapport souligne également la nécessité de viser la transition écologique.
Par ailleurs, la mission souligne que les Agences Régionales de Santé (ARS), en charge de l’instruction de 95 % des projets, doivent conserver les renforts en personnel déployés depuis 2022 pour assurer un suivi efficace jusqu’en 2028. Toute réduction anticipée de ces effectifs risquerait de ralentir le processus et de fragiliser l’expertise acquise. Enfin, pour limiter les conflits d’intérêts et garantir la transparence des décisions, le rapport recommande d’adopter une charte de l’expertise définissant des règles claires en matière de prévention des conflits.
Le renforcement de la gestion patrimoniale hospitalière constitue un autre enjeu majeur. Aujourd’hui, il n’existe pas de recensement national précis du patrimoine immobilier des établissements de santé, ce qui complique la planification des investissements (voir annexe 5 du rapport). Le rapport préconise donc de confier à l’ANAP la mission d’établir un inventaire exhaustif des bâtiments hospitaliers, en s’appuyant sur les bases de données existantes. Cet inventaire permettrait de mieux évaluer l’état des infrastructures, leur potentiel d’évolution et leur impact environnemental afin de guider les choix d’investissement au-delà du seul cadre du plan Ségur. En complément, l’ANAP devrait être chargée d’élaborer une stratégie patrimoniale hospitalière nationale, permettant d’optimiser l’utilisation des infrastructures et d’anticiper les besoins de modernisation.
L’un des principaux freins identifiés à la mise en œuvre des investissements concerne la faiblesse des maîtrises d’ouvrage hospitalières. De nombreux établissements, en particulier les plus petits, ne disposent pas des compétences techniques suffisantes pour piloter des projets immobiliers d’envergure, ce qui entraîne des retards et des surcoûts. Le rapport propose de confier la maîtrise d’ouvrage des opérations aux établissements supports des Groupements hospitaliers de territoire (GHT), qui disposent généralement d’équipes plus expérimentées. Cette évolution nécessiterait une modification législative mais permettrait d’assurer une meilleure coordination des investissements à l’échelle des territoires et d’intégrer les projets dans une vision plus large des parcours de soins.
Dans les cas où les équipes des GHT ne seraient pas suffisamment structurées, le rapport envisage la mise en place d’un maître d’ouvrage délégué national ou régional, qui pourrait prendre en charge certaines opérations complexes. Ce modèle, déjà expérimenté dans d’autres secteurs comme la justice ou l’enseignement supérieur, offrirait une alternative aux établissements les plus fragiles en matière d’ingénierie immobilière. Une modification législative serait nécessaire pour sécuriser ce dispositif et clarifier la responsabilité des différents acteurs.
Enfin, le renforcement des compétences en maîtrise d’ouvrage passe également par la formation des dirigeants hospitaliers et des professionnels en charge des projets immobiliers. Le rapport souligne la nécessité de développer des formations spécifiques à la conduite d’opérations pour les directeurs d’hôpitaux et les présidents de Commission médicale d’établissement (CME), afin de mieux les préparer aux défis liés aux investissements immobiliers. Par ailleurs, face aux difficultés de recrutement d’ingénieurs spécialisés dans le secteur hospitalier, il est recommandé de créer une filière d’ingénierie hospitalière en partenariat avec les grandes écoles du bâtiment. Cette initiative permettrait de renforcer l’attractivité des métiers liés aux infrastructures hospitalières et de garantir un vivier de compétences pour accompagner les établissements dans leurs projets de modernisation.
Quinze recommandations sont formulées, à échéance 2025 particulièrement sur le renforcement de la gestion du patrimoine hospitalier et les maîtrises d'ouvrage.
Lors du conseil d’administration de l’ANAP du 31 janvier, le ministère chargé de la santé, suivant les préconisations de l’IGAS, a donc officialisé l’intégration des fonctions du CSIS à l’ANAP, à compter du 1er avril 2025. Le processus et les étapes de validation des projets immobiliers soumis au dispositif de suivi national restent inchangés.
A compter du 1er avril, les experts du CSIS pourront rejoindre le réseau des experts de l’ANAP, qui réunit aujourd’hui 700 professionnels en poste. Les missions d’accompagnement sur l’investissement continueront de s’appuyer sur des équipes pluridisciplinaires composées notamment de médecins, de soignants, d’ingénieurs, d’architectes, avec une logique de pair-à-pair. A partir de leur analyse menée sur le terrain, ils formuleront une recommandation au comité national de pilotage.