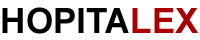Améliorer l'accès aux soins dans les territoires : les contres-propositions du Sénat sur la régulation
Publié en avril 2025
Exercice de la profession Installation ARS Accès aux soins Déserts médicaux
Voir également :Les difficultés d'accès aux soins dans les territoires sont à ce point chronicisées que les propositions de lois se succèdent depuis quelques années pour tenter de trouver les parades, au nombre desquelles la régulation de l'installation des médecins.
Déjà en 2023, lors de l'examen de la proposition de loi du député Frédéric Valletoux, les propositions de régulation de l’installation des médecins ou des spécialistes avaient été rejetées par le Sénat comme l'Assemblée nationale.
Quelques mois plus tard, changement d'analyse : l'Assemblée nationale adopte l'article 1er de la proposition de loi visant à lutter contre les déserts médicaux, d’initiative transpartisane, pourtant supprimé en commission des affaires sociales (voir notre veille du 04 avril 2025 “Désertification médicale : le retour de la régulation”). L'article 1er adopté “crée une autorisation d’installation des médecins, délivrée par l’ARS. En zone sous‑dotée, l’autorisation est délivrée de droit pour toute nouvelle installation. Dans tous les autres cas, c’est‑à‑dire lorsque l’offre de soins est au moins suffisante, l’autorisation est délivrée uniquement si l’installation fait suite à la cessation d’activité d’un praticien pratiquant la même spécialité sur ce territoire [= même zone]. L’autorisation d’installation intervient après consultation, par l’ARS, de l’Ordre départemental des médecins” (exposé des motifs de la proposition de loi).
Une contre-proposition a été déposée au Sénat le 28 mars dernier, qui vise également à “Améliorer l'accès aux soins dans les territoires” et qui, tout en partageant les mêmes constats, propose une solution différente.
Cette proposition de loi repose sur quatre grands principes : la préservation du modèle libéral de la médecine, la souplesse administrative, la juste rémunération des professionnels de santé et la coordination accrue des soins.
Le texte se déploie en quatre chapitres structurés pour répondre aux défis à court terme, tout en préparant des transformations durables.
Le chapitre II, qui répond à l'Assemblée nationale, constitue sans doute la partie la plus ambitieuse – et potentiellement la plus controversée – du texte. Il conditionne l’installation des médecins en zones sur-dotées à un engagement d’exercice partiel dans des zones sous-denses, instaurant de fait une régulation partielle de la liberté d’installation. Concrètement, un médecin généraliste ne pourra s’installer librement dans ces zones que s’il s’engage parallèlement à exercer une activité à temps partiel dans une zone sous-dense. Cette logique de compensation territoriale repose sur le principe de solidarité interterritoriale : pour pouvoir bénéficier de l’attractivité d’un territoire déjà bien pourvu, le professionnel devra contribuer à rééquilibrer l’offre de soins ailleurs. Pour les spécialistes, l’autorisation en zone sur-dense est soumise à la cessation d’activité d’un confrère sauf exceptions expressément prévues – notamment s’ils s’engagent eux aussi à une activité à temps partiel en zone sous-dotée, ou si l’Agence Régionale de Santé (ARS) estime leur présence indispensable au maintien d’un accès minimal aux soins dans leur zone d’installation. La loi entend aussi faciliter les pratiques multisites, encourager les dépassements d’honoraires encadrés en zone sous-dense, et sécuriser les remplacements dans ces territoires. Une disposition expérimentale ouvre la voie à une flexibilité du droit du travail pour les centres de santé à but non lucratif en difficulté de recrutement, via des contrats dérogatoires à durée déterminée. Enfin, les articles 8 à 10 du chapitre reconnaissent l’importance des praticiens à diplôme hors Union européenne (Padhue) dans l’équilibre actuel de l’offre de soins. Ils prévoient de mieux évaluer les besoins de recrutement de ces professionnels, de simplifier leurs procédures d’autorisation d’exercice, et surtout, de favoriser leur affectation dans les territoires sous-dotés, notamment lorsqu’ils exercent dans des structures d’exercice coordonné. Ces ajustements, s’ils sont bien mis en œuvre, pourraient permettre d’intégrer durablement ces professionnels au système de santé tout en répondant à des besoins critiques dans certains territoires.
À suivre !