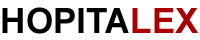Les schémas régionaux de santé
Publié en juin 2024 | FDH n°493 , p.6743
Agence régionale de santé ARS Projet régional de santé OQOS PRS Territorialisation Schéma régional de santé SRS Cadre d'orientation stratégique Programme régional
Voir également :PLAN
I. L’élaboration du schéma régional de santé
II. Les objectifs du schéma régional de santé
III. Le contenu du schéma régional de santé
A. Les objectifs qualitatifs et quantitatifs de l’offre de soins
B. Les objectifs quantitatifs de l’offre de soins
C. Les autres éléments contenus dans le schéma régional de santé
RÉFÉRENCES
Code de la santé publique : articles L1434-1 à L1434-15 ; articles R1434-1 à D1434-44
RÉSUMÉ
Le schéma régional de santé (SRS) s’inscrit dans le cadre de la territorialisation de la politique de santé. Il est l’un des trois documents qui composent le projet régional de santé (PRS) et constitue la traduction opérationnelle du cadre d’orientation stratégique.
Le SRS, établi pour 5 ans, détermine des prévisions d’évolution et des objectifs opérationnels, pour l'ensemble de l'offre de soins et de services de santé, y compris en matière de prévention, de promotion de la santé et d'accompagnement médico-social et ce, sur la base d'une évaluation des besoins sanitaires, sociaux et médico-sociaux.
ANALYSE
La politique de santé est nationale mais elle est mise en œuvre au niveau régional par les Agences régionales de santé (ARS) ; on parle alors de territorialisation de la politique de santé, qui fait l’objet du Chapitre IV : Territorialisation de la politique de santé (Articles L1434-1 à L1434-15) du Code de la santé publique.
Cette organisation de l’offre de santé est permise par la mise en place, dans chaque région, d’instruments de planification et de territoires ou zones spécifiques.
D’une part, l’ARS délimite les territoires de démocratie sanitaire à l'échelle infrarégionale, de manière à couvrir l'intégralité du territoire de la région. Ces territoires visent à mettre en cohérence des projets de l'ARS, des professionnels et des collectivités territoriales tout en prenant en compte de l'expression des acteurs du système de santé et notamment celle des usagers.
À ces territoires, s’ajoutent les zones, donnant lieu à la répartition des activités de soins et des équipements matériels lourds contenus dans le schéma régional de santé et à l'application aux laboratoires de biologie médicale des règles de territorialité.
D’autre part, l’instrument de planification majeur au niveau régional est le projet régional de santé (PRS). Il s’agit d’un document qui définit, en cohérence avec la stratégie nationale de santé et dans le respect des lois de financement de la sécurité sociale, les objectifs pluriannuels de l'ARS dans ses domaines de compétences, ainsi que les mesures tendant à les atteindre. Il tient compte notamment des contrats locaux de santé existant sur le territoire régional.
Le PRS est arrêté par le DG de l’ARS pour une durée de 5 ans.
L'article L1434-2 du CSP précise qu’il se compose de trois documents :
- Un schéma régional de santé (SRS), établi pour 5 ans sur la base d'une évaluation des besoins sanitaires, sociaux et médico-sociaux et qui détermine, pour l'ensemble de l'offre de soins et de services de santé, y compris en matière de prévention, de promotion de la santé et d'accompagnement médico-social, des prévisions d'évolution et des objectifs opérationnels.
- Un cadre d'orientation stratégique (COS), qui détermine des objectifs généraux et les résultats attendus à 10 ans et qui doit fixer les grands principes sur lesquels s’appuiera le SRS qui en constitue la traduction opérationnelle sur 5 ans.
- Et un programme régional relatif à l'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies.
Avant que la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 ne mette en place un document unique, le PRS se composait de trois schémas régionaux de mise en œuvre en matière de prévention, d'organisation de soins et d'organisation médico-sociale. Aujourd’hui, le SRS les reprend entièrement, hormis le SR de prévention qui relève de l’offre générale de soins.
Les schémas régionaux de santé viennent d’être renouvelés pour la période 2023-2028 alors que la réforme des autorisations d’activités de soins et des équipements matériels lourds est entrée en vigueur. À l’analyse, ils se révèlent très hétérogènes, voire opposés dans leur appréciation de la réglementation (Voir : Cormier Maxence, Heinrich Pauline, Les nouveaux SRS, les ARS au risque de l’hétérogénéité, RGDM, n°90, 2024).
I. L’élaboration du schéma régional de santé
Aux termes de l’article R1434-4 du CSP, le SRS est élaboré par l'ARS sur le fondement d'une évaluation des besoins. À cette fin, « elle effectue un diagnostic comportant une dimension prospective des besoins de santé, sociaux et médico-sociaux et des réponses existantes à ces besoins, y compris celles mises en œuvre dans le cadre d'autres politiques publiques.
Le diagnostic porte également sur la continuité des parcours de santé, l'identification d'éventuels points de rupture au sein de ces parcours et les difficultés de coordination entre professionnels, établissements ou services. »
L'élaboration du SRS implique donc une large évaluation des besoins pour ensuite planifier et organiser au mieux l'offre de santé sur le territoire régional.
Il tient compte notamment :
- De la situation démographique (pyramide des âges, répartition géographique, etc.) et épidémiologique (maladies chroniques, addictions, santé mentale, etc., autrement dit, la prévalence des pathologies et problèmes de santé dans la région) ainsi que de ses perspectives d'évolution ;
- Des déterminants de santé et des risques sanitaires ;
- Des inégalités sociales et territoriales de santé notamment au travers des indicateurs socio-économiques de la population (revenus, niveau d'éducation, conditions de logement, etc.) qui influencent les déterminants sociaux de la santé, et l’offre de soins et services de santé existante sur le territoire (nombre et répartition des professionnels et établissements de santé, services médico-sociaux, etc.) ;
- De la démographie des professionnels de santé et de sa projection ;
- Des évaluations des projets régionaux de santé antérieurs et également du programme régional d'accès à la prévention et aux soins (PRAPS) pour identifier les besoins non couverts ;
- Le cas échéant, des besoins spécifiques de la défense, des contributions, moyens et interventions du service de santé des armées mentionnés au IV de l'article L. 1434-3. Les ARS peuvent d’ailleurs conclure avec un médecin (généraliste ou spécialiste), exerçant depuis moins d’un an, un contrat de début d’exercice à condition que le lieu d’exercice soit situé dans les territoires définis par l’ARS et caractérisés par une offre médicale insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux soins pour la spécialité concernée, identifiées dans les SRS en application de ce dernier alinéa (Voir : Le contrat de début d’exercice, FDH n° 475, p. 6575).
Saisi de la légalité de SRS, le juge administratif a confirmé la nécessité pour les ARS d’élaborer un diagnostic préalable fondé sur une évaluation des besoins et une analyse de l’offre réalisées de manière détaillée (Voir : TA Pau, 18 septembre 2012, n° 1100389 ; TA Châlons-en-Champagne, 11 février 2014, n° 1101074 ; TA Montpellier, 8 avril 2014, n° 1203154) et le Conseil d’État a rappelé l’obligation réglementaire de procéder à cette évaluation des besoins de santé tout en indiquant que si « le schéma régional de santé doit être élaboré sur le fondement d'une évaluation des besoins de santé, sociaux et médico-sociaux reposant elle-même sur un diagnostic tenant compte, notamment, des éléments qu'elles mentionnent, il n'en résulte pas en revanche que les éléments de ce diagnostic devraient nécessairement figurer dans le schéma régional de santé » (CE, 20 juillet 2023, n° 467648).
Cependant, selon Maxence Cormier et Pauline Heinrich, la publication des nouveaux SRS 2023-2028 démontre que les diagnostics sont, selon les régions, plus ou moins lacunaires. Par exemple, les diagnostics réalisés par l’ARS de Bretagne, de Normandie, de Provence-Alpes-Côte-d’Azur, ou encore de Nouvelle-Aquitaine ne présentent pas cette dimension prospective des besoins de santé et des réponses existantes à ces besoins. Selon eux, « Les informations contenues dans ces documents ne permettent pas de connaître l’état des besoins de santé de la population, ni l’état de l’offre et de la démographie des professionnels de santé concernés ou encore l’évolution attendue de ces données pour chaque territoire de santé et chacune activité de soins ou équipement matériel lourd. »
À l’inverse, l’ARS Occitanie a élaboré un diagnostic très détaillé en identifiant des diagnostics par territoire de démocratie sanitaire (correspondant à chaque département) en plus de celui effectué pour la région.
De surcroît, certaines ARS renvoient l’élaboration du diagnostic après la publication de leur SRS.
Ainsi, il y a une importante hétérogénéité dans l’appropriation de la notion de diagnostic faite par les ARS.
Au terme de ce diagnostic, l’ARS élabore un SRS en cohérence avec le cadre d'orientation stratégique qui détermine des objectifs généraux et les résultats attendus à 10 ans et avec les dispositions des lois de financement de la sécurité sociale. Ce schéma doit tenir compte :
- Des exigences d'accessibilité, de qualité, de sécurité, de permanence, de continuité des prises en charge ;
- Des exigences d'efficience du service rendu et d'optimisation de la ressource publique ;
- Des spécificités des quartiers prioritaires de la politique de la ville, des zones de revitalisation rurale et des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins (mentionnées au 1° de l'article L. 1434-4) ;
- Des orientations des plans ou programmes nationaux de santé ;
- Des objectifs du programme coordonné élaboré par les conférences départementales des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie prévues par l'article L. 233-1 du CASF ;
- Le cas échéant, des besoins spécifiques de la défense mentionnés à l'article L. 1431-2.
Il est établi sur la base d'une évaluation des besoins sanitaires, sociaux et médico-sociaux et doit être actualisé en cohérence avec le protocole pluriannuel, qui a une durée de 5 ans, signé entre le ministre de la Défense et les ministres chargés de la Santé, de la Sécurité sociale et du budget ; ce protocole définit les relations et les engagements réciproques de ces ministères, dans le but de mieux répondre aux besoins de santé de la population, notamment aux besoins spécifiques de la défense dans le domaine de la santé.
Ainsi, conformément à l’article L1434-3 du CSP, lorsqu’il existe, le SRS doit prendre en compte :
1° Les besoins spécifiques de la défense ;
2° Les autres contributions du service de santé des armées à la politique de santé, notamment celles de ses centres médicaux du service de santé des armées (mentionnés à l'article L. 6326-1) ;
3° Sous réserve de la satisfaction de sa mission prioritaire mentionnée à l'article L. 6147-7 et de l'accord du ministre de la défense, les moyens pouvant être mis en œuvre par le service de santé des armées dans le cadre de la préparation du système de santé aux situations sanitaires exceptionnelles et du dispositif d'organisation de la réponse du système de santé en cas de situation sanitaire exceptionnelle ;
4° Les coopérations entre les éléments du service de santé des armées et les acteurs du système de santé mentionnés au I de l'article L. 6147-10.
Le SRS doit être établi et actualisé en cohérence avec les schémas départementaux d’organisation sociale et médico-sociale relatifs aux personnes handicapées ou en perte d’autonomie, lorsque sont concernés les EHPAD et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale, les établissements et les services, y compris les foyers d’accueil médicalisé, qui accueillent des personnes handicapées, et les établissements ou services à caractère expérimental (Voir : Filippi Isabelle, Clément Cyril, Duwime Léa, Le mémento de droit hospitalier, Bordeaux, LEH Édition, 2023, coll. "Ouvrages généraux" ).
En outre, il résulte des articles L. 1434-6 et R. 1434-1 du CSP que, préalablement à la publication de l’arrêté du PRS, une procédure de consultation doit être mise en œuvre par les ARS. Le DG de l’ARS n’est pas lié par l’avis rendu par les instances et autorités mentionnées 1° du I de l’article R. 1434-1 (la conférence régionale de la santé et de l’autonomie, les conseils départementaux de la citoyenneté et de l’autonomie, le préfet de région et les collectivités territoriales de la région), mais il a l’obligation de procéder à leur consultation. Cela permet aux instances de se prononcer sur le futur SRS.
Néanmoins, Maxence Cormier et Pauline Heinrich soulignent que, même si les ARS sont placées dans l’obligation de soumettre leurs SRS à la consultation, nombreuses sont celles qui ignorent ces dispositions en publiant un SRS différent de celui soumis aux instances de démocratie sanitaire et ne répondant pas nécessairement aux observations faites lors de la phase de consultation. À titre d’exemple, entre la phase de consultation et la publication du SRS, l’ARS de Nouvelle-Aquitaine a ajouté une implantation supplémentaire pour l’activité de médecine nucléaire sur un territoire de santé et l’ARS de Bretagne a fait de même pour l’activité de traitement du cancer pour la modalité « radiothérapie » (CORMIER Maxence, HEINRICH Pauline, préc.).
Enfin, il est établi pour 5 ans (article L1434-2 du CSP) et doit être révisé, après évaluation de l'atteinte de ses objectifs au moins tous les cinq ans (article R1434-8 du même code).
L’article L. 1434-5 du CSP précise que « L'illégalité pour vice de forme ou de procédure du projet régional de santé et de ses composantes prévues (...) ne peut être invoquée par voie d'exception après l'expiration d'un délai de 6 mois à compter de la prise d'effet du document concerné ».
De même, le SRS et les décisions d'autorisation d'activités ou d'équipements matériels lourds peuvent faire l’objet d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la Santé, qui statuera dans un délai maximum de 6 mois, après avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale. Cependant, selon l’article L. 6122-10-1, ce recours ne constitue pas un préalable obligatoire au recours contentieux.
La possibilité de former un recours contentieux direct contre le schéma régional de santé est relativement restreinte selon la jurisprudence. Il faut démontrer que le SRS a été pris pour l'application d'un autre acte réglementaire antérieur, comme l'arrêté fixant les zonages d'activités de soins et d'équipements ; en soi, l’arrêté adoptant le PRS, qui comprend le SRS, est considéré comme un acte non réglementaire.
Mais l'exception d'illégalité peut toujours être soulevée contre le SRS s'il sert de fondement à un autre acte attaqué.
II. Les objectifs du schéma régional de santé
Le SRS détermine, sur la base d'une évaluation des besoins sanitaires, sociaux et médico-sociaux les prévisions d'évolution de l'offre de soins, services de santé, prévention, promotion de la santé et accompagnement médico-social sur le territoire et les objectifs opérationnels à atteindre pour l'ensemble de cette offre.
Plus précisément, et aux termes de l’article R1434-6 du CSP, le SRS comporte des objectifs visant à :
- Développer la prévention et la promotion de la santé ;
- Améliorer l'organisation des parcours de santé en favorisant la coordination et la coopération des acteurs de l'offre sanitaire, sociale et médico-sociale, en particulier en mobilisant les équipes de soins primaires mentionnées à l'article L. 1411-11-1 et les communautés professionnelles territoriales de santé mentionnées à l'article L. 1434-12 ;
- Favoriser l'accès aux soins, à la prévention et à l'accompagnement, sur les plans social, géographique et de l'organisation, notamment des personnes en situation de handicap ou de perte d'autonomie et des personnes les plus démunies ;
- Préparer le système de santé à la gestion des situations sanitaires exceptionnelles déclinées dans le dispositif ORSAN mentionné à l'article L. 3131-11.
En outre, le SRS comporte des objectifs quantitatifs et qualitatifs visant à prévoir l'évolution de l'offre de soins par activité de soins et équipements matériels lourds (EML) mentionnés à l'article L. 6122-1 et de l'offre des établissements et services médico-sociaux. Ces objectifs tiennent compte des activités et équipements mentionnés dans l'arrêté prévu au II de l'article L. 6147-7. En effet, ces activités de soins et EML doivent être répartis par zone au regard de la situation locale et son évolution, mais la zone est ici comprise comme le lieu géographique de réalisation et non celui de l’établissement. Autrement dit, les zones déterminées à ce titre ne sont pas nécessairement liées aux départements de la région considérée (voir infra, III-A).
Pour atteindre ses objectifs, le SRS mobilise notamment les leviers suivants, énumérés par l’article R1434-9 du CSP :
1° La surveillance et l'observation de la santé ;
2° Les démarches d'amélioration continue de la qualité des soins et de la sécurité des usagers ;
3° La contractualisation avec les professionnels, structures et établissements de santé, les établissements et services médico-sociaux, et les acteurs de la prévention et de la promotion de la santé ;
4° La coordination ou la contractualisation avec les autres services de l’État et les collectivités territoriales et leurs groupements ;
5° Les mesures d'aide à l'installation des professionnels de santé ;
6° Les systèmes d'information, la télémédecine et la e-santé ;
7° Les outils d'appui et de coordination des acteurs du soin et des accompagnements sociaux et médico-sociaux, de la prévention et de la promotion de la santé ;
8° La formation et l'évolution des métiers et des compétences des acteurs de santé ;
9° La formation des représentants des usagers dans les instances où leur présence est nécessaire ;
10° La mobilisation de la démocratie sanitaire ;
11° Les investissements immobiliers et les équipements.
Ces leviers figurent dans le schéma régional de santé.
Enfin, l’ARS doit préciser les modalités de suivi et d'évaluation des dispositions prévues par le schéma, notamment en ce qui concerne l'efficience de ses dispositions.
III. Le contenu du schéma régional de santé
Le SRS détermine, pour l’ensemble de l’offre de soins et de services de santé, y compris en matière de prévention, de promotion de la santé et d’accompagnement médico-social, des prévisions d’évolution et des objectifs opérationnels.
L'article L1434-2 précise que les objectifs opérationnels « portent notamment sur la réduction des inégalités sociales et territoriales en matière de santé, sur l'amélioration de l'accès des personnes les plus démunies à la prévention et aux soins, sur le renforcement de la coordination, de la qualité, de la sécurité, de la continuité et de la pertinence des prises en charge sanitaires et médico-sociales ainsi que sur l'organisation des parcours de santé, notamment pour les personnes atteintes de maladies chroniques et les personnes en situation de handicap ou de perte d'autonomie. Ils visent également à organiser la préparation du système de santé aux situations sanitaires exceptionnelles dans le cadre du dispositif d'organisation de la réponse du système de santé en cas de situation sanitaire exceptionnelle " ORSAN " mentionné à l'article L. 3131-11. »
Ces objectifs peuvent être mis en œuvre par les contrats territoriaux de santé, y compris en santé mentale, ou par les contrats locaux de santé.
Le champ du SRS est très large.
A. Les objectifs qualitatifs et quantitatifs de l’offre de soins
Les zones du SRS donnent lieu à la répartition des activités de soins et des équipements matériels lourds et sont délimitées par le DG de l’ARS pour chaque activité de soins définie à l'article R. 6122-25 et équipement matériel lourd défini à l'article R. 6122-26. Ces zones peuvent être communes à plusieurs activités de soins et équipements matériels lourds.
Aux termes de l’article R. 1434-30, pour la délimitation de ces zones les ARS doivent prendre en compte, pour chaque activité de soins et pour chaque équipement matériel lourd :
1° Les besoins de la population ;
2° L'offre existante et ses adaptations nécessaires ainsi que les évolutions techniques et scientifiques ;
3° La démographie des professionnels de santé et leur répartition ;
4° La cohérence entre les différentes activités de soins et équipements matériels lourds soumis à autorisation ;
5° Les coopérations entre acteurs de santé.
La délimitation des zones concourt à garantir pour chaque activité de soins et équipement matériel lourd la gradation des soins organisée pour ces activités, la continuité des prises en charge et la fluidification des parcours, l'accessibilité aux soins, notamment aux plans géographique et financier, la qualité et la sécurité des prises en charge et l'efficience de l'offre de soins.
Au sein des différentes zones, les ARS doivent fixer, dans le SRS, les objectifs quantitatifs et qualitatifs de l’offre de soins pour chaque activité de soins ou équipement matériel lourd. Pour cela, une grande liberté est laissée aux ARS.
En effet, selon l’article L1434-3, le SRS :
- Fixe, pour chaque zone donnant lieu à la répartition des activités de soins et des équipements matériels lourds mentionnés à l'article L. 1434-3 :
a) Les objectifs quantitatifs et qualitatifs de l'offre de soins, précisés par activité de soins et par équipement matériel lourd, selon des modalités définies par décret ;
b) Les créations et suppressions d'activités de soins et d'équipements matériels lourds ;
c) Les transformations, les regroupements et les coopérations entre les établissements de santé ;
En clair, il s’agit ici de répartir les activités et équipements hospitaliers le plus efficacement possible (par exemple en instaurant des coopérations ou des regroupements entre établissements de santé). En revanche, le schéma mis en place peut être source de contestations. À titre d’exemple, dans le cadre d'un recours contre un schéma interrégional d'organisation des soins, le Conseil d’État a déclaré que « la suppression du service d'allogreffes pédiatriques du centre hospitalier universitaire de Brest a eu pour objectif d'améliorer la qualité des soins offerts aux enfants en renforçant les équipes médicales responsables de leur traitement ; en effet, comme le relève l'avis de l'agence de biomédecine du 6 septembre 2007, la qualité des greffes pédiatriques rend souhaitable la prise en charge d'un nombre minimal de patients chaque année et seules les équipes de Nantes et de Rennes satisfont pleinement à cette recommandation dans l'inter-région Ouest » (CE, 23 oct. 2009, n° 325562).
- Fixe les objectifs quantitatifs et qualitatifs de l'offre des établissements et des services médico-sociaux mentionnés aux b, d et f de l'article L. 313-3 du CASF, sur la base d'une évaluation des besoins sociaux et médico-sociaux, prévue au 2° de l'article L. 1434-2 du présent code ;
- Définit l'offre d'examens de biologie médicale mentionnée à l'article L. 6222-2, en fonction des besoins de la population ;
Or, il ressort de l’analyse des différents SRS 2023-2028, effectuée par Maxence Cormier et Pauline Heinrich, une hétérogénéité dans la détermination des implantations ; « si certaines ARS éprouvent des difficultés à s’approprier la réforme des autorisations sanitaires et restent prudentes quant à la détermination d’implantations pour les cinq années à venir, d’autres n’hésitent pas à augmenter très largement le nombre d’implantations ».
En effet, alors que l’Île-de-France et l’Occitanie, ont considérablement augmenté le nombre d’implantations pour les différentes activités de soins et les équipements de radiologie diagnostique, les autres régions ne prévoient pas de nouvelles implantations mais stabilisent l’offre existante, voire même, réduisent le nombre d’implantations (c’est le cas du Centre-Val-de-Loire). Cela s’explique notamment, pour certaines activités, par le manque de ressources médicales et paramédicales, par les difficultés liées à la démographie des professionnels médicaux et soignants et par la nécessité de restructurer l’offre de soins (Voir : Cormier Maxence, Heinrich Pauline, Les nouveaux SRS, les ARS au risque de l’hétérogénéité, préc).
B. Les objectifs quantitatifs de l’offre de soins
Les objectifs quantitatifs, prévus aux articles D6121-6 à D6121-10 du CSP, déterminent le périmètre de l’offre de soins sur une zone et portent sur les activités de soins et les équipements matériels lourds.
Aux termes des articles D6121-7 et D6121-9, ils sont exprimés :
- Pour les activités de soins, par zones en nombre d'implantations assurant une activité de soins déterminée, ou en nombre d'implantations des équipements et services assurant une activité de psychiatrie. Outre ces modalités, les objectifs peuvent aussi être exprimés, par zone, sur la base d’un temps maximum d'accès, dans un territoire de santé, à un établissement exerçant l’activité concernée ;
- Pour les équipements matériels lourds, par zones, en nombre d'implantations disposant d'un équipement matériel lourd déterminé pour les équipements de scanner et d’imagerie par résonance magnétique (IRM).
Les objectifs sont quantifiés soit par un minimum et un maximum, soit par une progression ou une diminution au décours de la période d'exécution du schéma, éventuellement assorti d'échéances sur tout ou partie de cette période.
Il n’est pas rare que ces objectifs soient contestés. Par exemple, dans le cadre des OQOS de cardiologie interventionnelle, une ARS avait constaté dans son diagnostic que quatre départements de la région ne bénéficiaient d'aucun plateau technique permettant d'envisager l'implantation d'une activité d'angioplastie, et estimait ces quatre sites suffisants. La Cour administrative d’appel de Bordeaux, saisie d’un sursis à exécution, souligne alors qu’elle s’est référée « aux seules statistiques de ce département en matière de mortalité et de démographie » et n’a pas tenu « compte de façon précise et argumentée de l'accessibilité aux structures de cardiologie interventionnelle pour les territoires éloignés des grandes villes de la région ». Ainsi, « En l'état du dossier, le moyen tiré de ce qu'en fixant uniformément, (...), les zones afférentes à la cardiologie interventionnelle, (...), dans un unique cadre départemental, par référence aux territoires de démocratie sanitaire qui ont d'autres objectifs, l'ARS n'a pas appliqué les critères prévus par l'article R. 1434-30 » est de nature à justifier l’annulation (CAA Bordeaux, 15 septembre 2020, n° 20BX01836).
À l’inverse, dans la même affaire, le Conseil d’État a déclaré « qu’en estimant que les besoins de santé de la population de cette zone d'activité de soins étaient en l'espèce globalement satisfaits et que, pour les populations résidant dans des communes isolées situées à l'écart des axes autoroutiers à l'extrême sud du département, pour lesquelles l'accessibilité en urgence à un plateau de technique d'angioplastie coronaire nécessite l'utilisation de moyens héliportés, aucun établissement de santé n'était en capacité de remplir les conditions d'implantation d'une telle activité, la DG ARS n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de la zone d'activité de soins de la Haute-Garonne. Elle n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation en en déduisant que l'ouverture d'un site à Muret n'aurait pas pour effet d'améliorer l'accessibilité aux soins pour cette population et en décidant, dans ces conditions, de maintenir à quatre le nombre d'implantations d'angioplasties coronaires pour ce département » (CE, 20 juillet 2023, n° 467648).
C. Les autres éléments contenus dans le schéma régional de santé
Selon l’article L1434-3 du CSP, le SRS :
- Indique, dans le respect de la liberté d'installation, les besoins en implantations pour l'exercice des soins de premier recours mentionnés à l'article L. 1411-11 et des soins de second recours mentionnés à l'article L. 1411-12. Les dispositions qu'il comporte à cet égard ne sont pas opposables aux professionnels de santé libéraux ;
- Comporte, le cas échéant, un volet consacré à la mise en œuvre d'actions de sensibilisation de la population et de formation des professionnels de santé visant à limiter d'éventuelles contaminations par des maladies vectorielles ;
- Comporte, le cas échéant, un volet consacré aux besoins de santé spécifiques des populations des zones de montagne, notamment en termes d'accès aux soins urgents et d'évacuation des blessés, et tenant compte des spécificités géographiques, démographiques et saisonnières de ces territoires ;
- Comporte, le cas échéant, un volet consacré à la mise en œuvre des accords internationaux de coopération sanitaire applicables dans les territoires et collectivités mentionnés au dernier alinéa de l'article L1434-2, qui porte notamment sur l'organisation de la continuité des soins, l'accès aux soins urgents ainsi que sur la coordination en cas de crise sanitaire, dans le respect des attributions du représentant de l’État territorialement compétent et du DG de l’ARS.
Dans tous les cas énumérés, les autorisations accordées par le DG de l'ARS sont compatibles avec ces objectifs.
Le SRS est opposable, pour ce qui les concerne, aux établissements de santé, aux autres titulaires d'autorisations d'activités de soins et d'équipements matériels lourds, ainsi qu'aux établissements et services qui sollicitent de telles autorisations. Il est également opposable, dans les conditions prévues aux articles L. 313-4, L. 313-8 et L. 313-9 du CASF, aux établissements et services sociaux et médico-sociaux.
En outre, conformément à l’article L1434-2, le SRS comprend un programme relatif à la prévention des violences sexuelles et à l'accès aux soins des victimes de ces violences.
Enfin, le SRS précise les activités spécialisées impliquant une prise en charge directe des patients et prévoit leur implantation sur le territoire de santé (article R6123-32-6 du CSP).