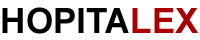PMA post mortem : l'intérêt de l'enfant au coeur de la réflexion
Publié en novembre 2025
Succession Assistance médicale à la procréation Procréation médicalement assistée PMA post mortem
Voir également :Voir également dans Hopitalex :
Deux arrêts de la Cour d'appel de Paris font grand bruit depuis leur publication car ils concernent la problématique de la PMA post-mortem.
L'arrêt n° 24/10294 du 14 octobre 2025 a trait à la demande d'établissement de la paternité d'une enfant née plus de 18 mois après le décès de son père (en 2018) qui avait déposé son sperme et consenti à sa conservation par une clinique espagnole (en 2016). Le défunt avait, de plus, autorisé par un testament olographe, établi peu après l'engagement du processus de fécondation in vitro (en février 2018), “son épouse à utiliser ses gamètes déposés en Espagne en vue d'une nouvelle grossesse au cas où il viendrait à décéder prématurément ou serait dans l'incapacité de manifester sa volonté.” Le transfert d'embryon conçu avec les gamètes du défunt est effectué en novembre 2019.
Mme X a recherché en justice l'établissement de la filiation pour sa fille née en juillet 2020. Déboutée en première instance, elle obtient gain de cause devant la CA de Paris qui a raisonné au regard de l'intérêt de l'enfant car le refus de reconnaître sa filiation “porte, au regard des finalités législatives en cause, une atteinte excessive à la vie privée de [S], dont l'intérêt supérieur commande de voir consacrer juridiquement le lien l'unissant à [K] [M], qui correspond à la réalité de sa vie privée et familiale, telle qu'elle la vit dans les faits.” Pour autant, la cour a fermement rappelé l'interdit légal de PMA post-mortem.
Dans la seconde affaire n°23/13317 du 14 octobre 2025, les faits étaient quelque peu différents. Un premier enfant était né du vivant de l'époux, après recours à une PMA (en 2019). Sa filiation est établie. L'enfant a été appelée à la succession de son père, décédé la même année et laissant également deux autres enfants majeurs d'une union précédente. Or, un quatrième enfant, [N] [I] [X], est né en 2021, d'un transfert d'embryon réalisé le 9 novembre 2020 ; l'acte de naissance espagnol mentionne clairement la double filiation (maternelle et paternelle), et son acte de naissance français comporte la mention marginale d'une filiation paternelle établie. Les deux enfants majeurs ont saisi la justice “aux fins essentielles de voir ordonner l'ouverture des opérations de comptes liquidation partage de la succession” de leur père et “de voir dire que l'enfant à naître dont Mme [K] [X] veuve [I] était enceinte ne sera pas appelé à la succession”. Le tribunal judiciaire de Paris exclut l'enfant [N] [I] [X] de la succession. En effet, les premiers juges ont retenu que “la notion de conception, […] ne pouvait donc correspondre qu'à un embryon déjà en gestation au moment du décès et non à un embryon en attente d'implantation” au regard de la loi française (application combinée des articles L2141-2 du code de la santé publique et 725 du code civil). Le transfert d'embryon ayant eu lieu après le décès de son père, l'enfant ne pouvait être héritière. La CA de Paris acquiesce puis se penche sur la loi espagnole pour convenir que le consentement de défunt “à une procréation post mortem est présumé puisque, au moment de son décès, avait été engagé un processus d'assistance médicale à la procréation pour le transfert d'embryons créés avant son décès.” En effet, l'article 9 de la loi espagnole du 26 mai 2006 n°14/2006 sur les techniques de procréation assistée “autorise la procréation post mortem dans les douze mois du décès de ce dernier si le mari y a auparavant consenti”. Se plaçant encore du côté de l'intérêt de l'enfant, la Cour considère que la mise à l'écart de l'enfant, dans la succession, constitue "une ingérence disproportionnée dans sa vie familiale" ainsi qu'au droit au respect de ses biens et à l’égalité de traitement.
Il est donc manifeste que l'appréciation de la Cour, dans ces deux affaires, a reposé sur l'analyse stricte et littérale de la réglementation française, qui proscrit la PMA post-mortem, confrontée à la situation concrète des enfants en cause ; dans les deux cas, la CA de Paris a fait primer une atteinte excessive (premier arrêt) et une ingérence disproportionnée (2e arrêt) aux droits des enfants.