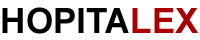Médecins et procédure pénale : le rapport du CNOM pour aider les professionnels sollicités
Publié en mars 2025
Ordre des médecins Dossier médical Respect du secret professionnel Saisie Secret professionnel Secret médical Réquisition Témoignage Audition Perquisition Auditions
Voir également :Voir également dans Hopitalex :
Le rapport du Conseil national de l’Ordre des médecins adopté en décembre 2024 traite des interactions entre les médecins et la procédure pénale, notamment en ce qui concerne les réquisitions judiciaires, les saisies de dossiers médicaux et les auditions ou témoignages en justice.
Il souligne que les médecins sont régulièrement sollicités par les autorités judiciaires pour réaliser des examens médicaux, fournir des informations ou être entendus dans le cadre d’enquêtes et de procès. Ces interventions se heurtent toutefois au principe fondamental du secret médical, qui est au cœur de la relation de confiance entre le patient et son médecin.
Une réquisition est “un ordre de l’autorité publique à une personne physique ou morale, d’accomplir un acte ou une prestation, notamment celle de remettre des documents ou des informations”. Les réquisitions sont ainsi distinguées selon leur finalité : constatations, examens techniques ou scientifiques et remise d’informations couvertes par le secret médical.
Les réquisitions
1. Les réquisitions portant sur des constatations, examens techniques ou scientifiques
Ces réquisitions imposent aux médecins de procéder à des actes médicaux spécifiques dans le cadre d’une enquête pénale (examen médical d’une personne en garde à vue, prise de sang pour vérifier une alcoolémie, examen externe d’un corps dans le cadre d’une enquête de décès, ou encore la détermination d’une Incapacité Totale de Travail (ITT).
Le médecin requis doit informer la personne examinée de la mission qui lui est confiée et du cadre juridique de son intervention. Il est tenu de respecter ses obligations déontologiques et de limiter son rapport aux faits constatés, en restant objectif et prudent. Dans certains cas, notamment en psychiatrie, il peut être sollicité pour évaluer la personnalité, le discernement ou la dangerosité d’un individu. Toutefois, il ne peut répondre qu’aux questions relevant de son champ de compétence.
Sauf exceptions, le médecin ne peut refuser de répondre à une réquisition. L’article L. 4163-7 du Code de la santé publique et l’article R. 642-1 du Code pénal prévoient des sanctions en cas de refus injustifié. Toutefois, trois motifs légitimes permettent à un médecin de refuser une mission :
- Une inaptitude physique l’empêchant d’accomplir l’acte demandé ;
- L’absence de compétence pour réaliser l’examen requis ;
- Le fait d’être le médecin traitant de la personne concernée, ce qui pourrait poser un problème d’objectivité.
2. Les réquisitions à information
Les réquisitions à information visent à obtenir des documents ou des renseignements nécessaires à l’enquête pénale, ce qui peut inclure des éléments couverts par le secret médical. Ces demandes émanent d’un OPJ, d’un procureur ou d’un juge d’instruction.
Contrairement aux réquisitions pour examen médical, le médecin peut refuser de communiquer des informations couvertes par le secret professionnel. L’article 60-1 du Code de procédure pénale précise que l’infraction de refus de répondre à une réquisition ne lui est pas applicable dans ce cas. Néanmoins, il doit obligatoirement faire connaître sa réponse à l’autorité requérante, en précisant, le cas échéant, qu’il refuse de transmettre les informations demandées en raison du secret médical.
Le Conseil national de l’Ordre des médecins rappelle que le secret médical a un caractère d’intérêt général et que sa protection est essentielle au bon fonctionnement du système de santé. L’équilibre entre les exigences de la justice et la préservation de la confidentialité des informations médicales reste un enjeu crucial, régulièrement questionné dans la pratique judiciaire.
La saisie du dossier médical
La saisie d’un dossier médical peut intervenir sur réquisition judiciaire ou dans le cadre d’une perquisition.
La remise d’un dossier médical ne peut se faire qu’avec l’accord du médecin et en présence d’un représentant/membre de l’Ordre des médecins.
Lors d’une perquisition, seul un magistrat peut intervenir, et la loi impose la présence d’un conseiller ordinal pour garantir le respect du secret médical. Le rapport rappelle que le “cabinet médical” est largement entendu : établissement de santé, service médical, PMI, établissement hospitalier public ou privé, dans un service de médecine préventive.
Audition et témoignage en justice
Sauf exceptions légales, ils ne peuvent révéler des informations couvertes par le secret professionnel, même avec le consentement du patient.
Dans le cas du médecin auditionné (qui est tenu de se rendre à la convocation), le secret professionnel s'impose.
Cependant, si le médecin a procédé à un signalement judiciaire ou transmis des informations préoccupantes concernant un mineur, il est délié du secret pour ces seuls faits.
S'agissant du témoignage, le respect du secret s'impose encore sauf dans les cas de dérogations légales prévues par l'article 226-14 du code pénal.