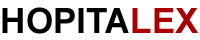La téléconsultation au crible de la Cour des Comptes
La Cour des comptes a été saisie par la commission des affaires sociales du Sénat pour évaluer l’impact des téléconsultations sur l’accès aux soins, la qualité de la prise en charge et les conditions d’exercice des professionnels de santé. Cette analyse s’inscrit dans le prolongement des travaux antérieurs de la Cour sur la télémédecine (2017) et la télésanté (2021). Depuis leur remboursement par l’assurance maladie en 2018, les téléconsultations représentent une modalité de consultation à distance qui, bien que prometteuse en matière d’accessibilité et d’efficience du système de santé, peine à s’imposer durablement dans l’offre de soins.
Elle vient de rendre public son rapport « Les téléconsultations – Une place limitée dans le système de santé, une stratégie à clarifier pour améliorer l’accès aux soins » (avril 2025).
D’abord perçue comme un levier de transformation du système de santé, notamment pour répondre aux inégalités territoriales d’accès aux soins, la téléconsultation a connu une croissance fulgurante durant la pandémie de Covid-19. Elle a permis la continuité des soins en période de confinement et une réduction de la pression sur les services d’urgences. Pourtant, cette dynamique s’est fortement essoufflée après la crise sanitaire. En 2023, les téléconsultations ne représentaient que 2,2 % de l’activité des médecins généralistes et 1,4 % de celle des établissements hospitaliers. Ces chiffres restent très inférieurs à ceux observés dans d’autres pays européens, particulièrement les pays nordiques.
La faible intégration de la téléconsultation dans les pratiques professionnelles s’explique notamment par des réticences médicales persistantes, des freins structurels liés à l’organisation du système de santé et l’absence d’un pilotage stratégique clair. L’État n’a pas défini d’objectifs opérationnels suffisamment précis dans sa convention d’objectifs et de gestion avec la Cnam pour la période 2023-2027. Les dispositifs territoriaux, tels que les maisons de santé ou les communautés professionnelles territoriales de santé, qui auraient pu constituer des vecteurs de développement des téléconsultations, sont faiblement mobilisés.
De plus, les téléconsultations ne bénéficient pas aux publics qui devraient en être les principaux destinataires : les personnes âgées en établissements médico-sociaux, les patients atteints de maladies chroniques, les personnes en situation de handicap ou placées sous main de justice. En pratique, ce sont des patients jeunes, urbains, souvent sans médecin traitant, qui y ont le plus recours, concentrant les usages en Île-de-France.
Sur le plan économique, les dépenses liées aux téléconsultations demeurent modestes et maîtrisées. En 2023, elles représentaient seulement 3 % des remboursements des consultations médicales. La tarification différenciée, les contrôles renforcés sur les actes réalisés par les plateformes et l'encadrement des arrêts de travail ont permis de limiter les dérives.
La Cour des comptes souligne toutefois l’utilité potentielle des téléconsultations pour améliorer l’efficience du système de santé, à condition de clarifier la stratégie nationale, d’ajuster le cadre réglementaire et d’adapter les mécanismes de financement. Elle recommande de mieux cibler les aides à l’équipement, d’assouplir certaines règles de territorialité, de renforcer la contribution des hôpitaux de proximité et de reconnaître pleinement le rôle subsidiaire que pourraient jouer les plateformes dans la prise en charge des soins non programmés.
Enfin, la garantie de la qualité et de la sécurité des soins constitue un enjeu fondamental. La Cour appelle à renforcer l’évaluation des pratiques, notamment en matière de prescriptions d’antibiotiques, et à mieux encadrer les sociétés de téléconsultation à travers un dispositif d’agrément qui entrera en vigueur en 2025. Ces exigences visent à éviter toute dérive commerciale contraire aux principes de la médecine de proximité et coordonnée.
Ainsi, dans un contexte de tensions croissantes sur l’offre de soins, le développement encadré et ciblé des téléconsultations pourrait répondre aux impératifs d’équité, de continuité et d’efficience, à condition qu’il soit adossé à une stratégie cohérente, partagée et rigoureusement suivie par les pouvoirs publics.