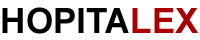Les violences sexuelles et sexistes
PLAN
I. L’identification et la gestion des violences sexuelles et sexistes en santé
A. La typologie des violences sexuelles et sexistes (VSS)
B. Les obligations des établissements de santé dans la prise en charge des victimes de VSS
II. Les sanctions
A. Les sanctions dans le cadre disciplinaire
B. Les sanctions dans le cadre pénal
RÉFÉRENCES
Code général de la fonction publique, article L131-3 ; article L135-6 A à L135-6 ; article L532-1 à L532-13) et R135-1 à R134-10
Code pénal, article 222-22 à 222-33-1 et 222-33-1-1
Code de la santé publique, article R6152-74 ; article R6152-370 ; article R6152-530 ; article R6152-626 ; article R6152-930
RÉSUMÉ
Les violences sexistes et sexuelles (VSS) regroupent un ensemble d'actes portant atteinte à la dignité et à l'intégrité des individus, qu'il s'agisse de comportements sexistes, de harcèlement sexuel, d'agressions sexuelles ou de viols. Bien que leur reconnaissance juridique soit plus récente que celle du harcèlement, les VSS font désormais l'objet d'une réglementation renforcée, notamment dans la fonction publique. Ces violences, interdites par le code général code général de la fonction publique, le code pénal, engagent la responsabilité des auteurs et des employeurs. Les évolutions législatives et les dispositifs de signalement mis en place permettent aujourd'hui une meilleure prévention et une prise en charge accrue des victimes.
ANALYSE
L’incrimination des violences sexistes et sexuelles dans la fonction publique hospitalière a été renforcée par la loi du 3 août 2018, qui a introduit de nouvelles infractions comme l’outrage sexiste et le voyeurisme, et modifié les définitions du harcèlement sexuel et moral dans le Code pénal.
La circulaire du 3 septembre 2018 a précisé les dispositifs de lutte contre ces violences, complétée par le décret du 6 novembre 2024 intégrant ces dispositions dans la partie réglementaire du Code général de la fonction publique (CGFP). Désormais, tous les établissements de santé doivent mettre en place un dispositif de signalement permettant aux victimes et témoins de rapporter les faits, d’être orientés vers des services de soutien et d’assurer la transmission aux autorités compétentes.
Le ministre chargé de la santé et de l’accès aux soins, est intervenu afin de lever les freins au signalement, renforcer l’efficacité des procédures, sensibiliser à la lutte et la prévention contre les violences sexuelles est sexistes (VSS).
Ces évolutions visent à garantir un environnement de travail sécurisé et respectueux pour l’ensemble des professionnels de santé.
I – L’identification et la gestion des violences sexuelles et sexistes en santé
A. La typologie des violences sexuelles et sexistes (VSS)
Une violence sexiste est un acte préjudiciable commis contre une personne sur la base de son genre, de son identité de genre, son orientation sexuelle ou d’autres caractéristiques sexuelles. Une violence sexuelle quant à elle, est une forme d’agression physique à caractère sexuelle ou rapport non consenti comme le viol.
Le code général de la fonction publique prohibe tout agissement sexiste envers un agent public (article L135-6 A CGFP) :
Aucun agent public ne doit subir des atteintes volontaires à son intégrité physique, des actes de violence, des menaces ou tout autre acte d'intimidation.
Aucun agent public ne peut faire l'objet de mesures mentionnées au premier alinéa de l'article L. 135-4 pour avoir :
1° Subi ou refusé de subir les actes mentionnés au premier alinéa du présent article ;
2° Exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces actes ;
3° De bonne foi, relaté ou témoigné de tels actes.
Dans les cas prévus aux 1° à 3° du présent article, les agents publics bénéficient des protections prévues aux I et III de l'article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent public ayant procédé ou enjoint de procéder aux actes définis au premier alinéa du présent article.
Les violences sexistes et sexuelles (VSS) regroupent plusieurs comportements et infractions.
Il faut d’abord citer le harcèlement sexuel dont les sanctionné sont mentionnées à l’article 222-33 du code pénal (CP) qui est « le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. » Mais c’est aussi les pressions répétées dans le but réel est d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit cherché au profit de l’auteur ou d’un tiers .
Le harcèlement sexuel est une notion large et ne fait pas nécessairement référence à la recherche d’une faveur sexuelle. C’est dans ce sens, que la Cour d’appel de Orléans le 7 février 2017 a considéré que le « harcèlement sexuel peut consister en un harcèlement environnemental ou d’ambiance ». En l’espèce, une salariée a été victime d’un environnement de travail ponctué de blagues, de propos insultants envers les femmes, de photographie sur les murs de l’open space, représentant ses collègues de la rédaction dans des positions déplacées, de fonds d’écran d’ordinateur avec des femmes nues. La victime n’était pas directement la cible de ces propos ou insultes, mais les juges ont retenu la qualification du harcèlement sexuel.
La cour administrative d’appel de Nantes (CAA Nantes, 21 juillet 2023, n°22NT03960) a considéré qu’un agent ne peut pas être reconnu coupable de harcèlement sexuel pour avoir montré à une collègue une photographie de lui-même en maillot de bain lorsqu’il était jeune. En l’espèce, ce fait isolé, dépourvu de pression ou d’intention visant à obtenir un acte sexuel, ne permettait pas de caractériser un comportement relevant du harcèlement sexuel.
L’article L133-1 du code général de la fonction publique reprend les dispositions de l’article 222-33 du code pénal (CP) sur le harcèlement sexuel.
L’outrage sexiste, dont les sanctions sont prévues à L’article R625-8-3 du code pénal, est défini comme le fait « d’imposer à une personne tout propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui soit porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit créé à son encontre une situation intimidante, hostile ou offense ». Cela sera le cas par exemple d’un geste imitant ou suggérant un acte sexuel ou encore un commentaire dégradant sur la tenue ou l’apparence physique d’une personne. L’outrage sexuel ne requiert pas un acte répété comme pour les cas de harcèlement sexuel, un seul acte pourra caractériser l’infraction.
L’injure est définie à l’alinéa 2 de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de presse : « toutes expression outrageante, termes de mépris, ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait ».
Une injure peut être un SMS envoyé à la victime ou encore prononcée devant les collègues au cours d’une réunion.
La cour administrative d’appel de Marseille vient préciser que l’injure ne peut se réduire à l’insulte relevant du langage courant car elle doit présenter une certaine gravité ( CAA Marseille, 3 novembre 2015, n°12MA01996)
Cette loi sur la liberté de presse définit également la notion de diffamation comme « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé »
La discrimination sexuelle correspond à tout traitement défavorable fondé sur le sexe, l’identité de genre ou l’orientation sexuelle, affectant des aspects comme l’embauche, la rémunération, ou l’accès à des droits ou services.
L’agression sexuelle, définie à l’article 222-22 du code pénal, est « toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise, ou dans les cas prévus par la loi, commise sur un mineur par un majeur ». Une agression sexuelle peut être caractérisée par un acte isolé d’attouchement imposé sans le consentement de la victime par exemple un baiser non désiré.
Le viol, dont les sanctions sont définies à l’article 222-23 du code pénal, est « toute atteinte sexuelle commise avec violences, contrainte, menace ou surprise ou dans les cas prévus par la loi, commise sur un mineur par un majeur ».
L’exhibition sexuelle, dont les sanctions pénales sont prévues à l’article 222-32 du code pénal sanctionne, est caractérisée dès lors qu’un acte sexuel, qu’il soit réel ou simulé, est imposé à la vue d’autrui dans un lieu accessible aux regards du public, et ce, même en l’absence d’exposition d’une partie dénudée du corps.
La chambre criminelle de la Cour de cassation précise que le lieu de travail est considéré comme un lieu accessible aux regards du public. Ainsi, se montrer entièrement nu dans les parties privées du lieu de travail constitue une exhibition sexuelle puisque tout membre du personnel peut s’y rendre. ( Cass., Chambre criminelle, 23 mai 2011, n° 00-85.672).
Un agent public travaillant pour l’assistance publique hôpitaux de Marseille (APHM) a été révoqué en raison de son comportement inapproprié. Il a notamment insulté et proféré des propos sexistes ainsi que des menaces à répétition à l’encontre de six collègues féminines et des cadres féminines du service. Ces agissements ont provoqué une dégradation du climat au sein du service et engendré un sentiment de peur parmi plusieurs membres du personnel. Ainsi, une décision de révocation a été prise et celle-ci a été confirmée par le juge administratif (CAA de Marseille, 3 juillet 2018, n°17MA03022).
En complément des infractions ci-dessus, d’autres comportements peuvent être sanctionnés, tels que : les diffusions de messages contraire à la décence, la captation d’image et la diffusion d’image impudique.
B. Les obligations des établissements de santé dans la prise en charge des victimes de VSS
Afin de limiter les situations de violences sexistes et sexuelles (VSS), les établissements de santé ont la responsabilité d’assurer la sécurité et la protection de leur personnel, comme prévu par l’article L136-1 du code général de la fonction publique qui dispose que « des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux agents publics durant le travail. »
L’article R135-1 du code général de la fonction publique (CGFP) mentionne que « le dispositif prévu à l’article L135-6 de signalement des atteintes volontaires à l’intégrité physique, des actes de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel, des agissements sexistes, des menaces ou de tout autre acte d’intimidation comporte :
- une procédure de recueil des signalements effectués par les agents s’estimant victimes ou témoins de tels comportements
- une procédure d’orientation des agents s’estimant victimes de tels comportements vers les services et professionnels compétents chargés de leur accompagnement et de leur soutien
- une procédure d’orientation des agents s’estimant victimes ou témoins de tels comportement vers les autorités compétentes pour prendre toute mesure de protection fonctionnelle appropriée au titre de l’article L134-1 et assurer le traitement des faits signalés, notamment par la réalisation d’une enquête administrative.
En outre, il existe une plateforme de signalement des violences à caractère sexuel et sexiste développée par le ministère de l’Intérieur qui permet d'informer et d'orienter toute personne dans leurs démarches et faciliter leur prise en charge par les autorités compétentes, grâce à des échanges avec des policiers ou gendarmes spécialement formés.
Pour prévenir les risques de VSS, les établissements de santé doivent prendre des mesures concrètes, notamment :
- En organisant des formations pour sensibiliser le personnel aux VSS, à leur prévention et aux moyens d’action comme recommandé dans le plan d’action du ministre chargé de la santé. Ils doivent informer les agents des recours possibles en cas de situation de VSS.
- Le directeur doit mettre en place le dispositif de signalement conformément à l’article R135-3 du CGFP. Il précise les modalités selon lesquels l’agent qui s’estime témoin ou victime :
- Adresse son signalement
- Expose les faits et, le cas échéant, fournit les informations ou documents, quels que soient leur forme ou leur support, de nature à étayer son signalement
- Fournit les éléments permettant, le cas échéant, un échange avec le destinataire du signalement.
Il est essentiel de permettre aux personnels de savoir à qui s’adresser pour signaler des violences et obtenir un accompagnement adapté.
Le signalement de VSS doit être pris en charge avec rigueur. Un entretien doit être organisé pour recueillir les paroles de la victime ou des témoins, de façon assez précise afin d’évaluer la situation. Il faut informer l’agent mis en cause, de la sanction qui sera envisagée, ses droits de consulter son dossier, de formuler des observations et de bénéficier d’un avocat, ainsi que, depuis peu, de son droit de se taire.
Le dispositif de signalement peut être mutualisé par voie de convention entre plusieurs établissements au titre de l’article R135-2 CGFP.
L’article R135-4 du CGFP précise les modalités à suivre en ce qui concerne la procédure de recueil des signalements. L’autorité compétente doit :
- informer sans délai l’auteur du signalement de sa réception, et les modalités suivant lesquelles il sera informé des suites qui y sont données
- garantir la confidentialité de l’identité de l’auteur du signalement et des personnes visées et des faits rapportés, y compris en cas de communication aux personnes ayant besoin d’en connaître pour le traitement du signalement
La responsabilité de l’employeur peut être engagée en cas de carence en matière de prévention, de protection et de traitement des violences dont peuvent être victimes les agents sur leur lieu de travail.
Dans son communiqué du 17 janvier 2025, Yannick Neuder, ministre chargé de la santé et de l’accès aux soins, a dévoilé le plan d’action du ministre chargé de la santé afin de lutter contre les VSS et permettre un meilleur suivi des victimes en améliorant le traitement des signalements. Pour ce faire, 9 mesures ont été prévues et en particulier la mise en place d’un référent dans chaque groupement hospitalier de territoire, pour intervenir en appui dans les enquêtes (mesure n°4) ou sensibiliser les étudiants en santé et le personnel à la prévention et à la lutte contre les VSS (mesure n°8). En outre, ce plan intègre la prévention et la lutte contre les VSS dans le référentiel de certification des établissements de santé par la Haute Autorité de Santé (HAS) dès le 21 janvier 2025 (mesure n°7) et la formation aux VSS dans le cadre de la certification périodique des professionnels de santé à ordre (mesure n°9).
Une prise en charge de la victime doit être organisé par la suite, afin de l’orienter elle ou les témoins. Dans cette procédure d’orientation, la victime ou les témoins doivent avoir connaissance de la nature des dispositifs mis en œuvre par les services et professionnels compétent, ainsi que les modalités d’accès à ces services et professionnels ( article R135-5 CGFP).
Des mesures conservatoires peuvent ainsi être prise par l’établissement au titre de l’article L134-5. Ce dernier est tenu de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne. Les mesures doivent être prises sans délai (article L134-6 CGFP).
Elles peuvent amener à une suspension à titre conservatoire de la personne mise en cause (article L531-1 CGFP). Toutefois, l’agent conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément de traitement. L’établissement peut également changer l’affectation de l’auteur de l’acte de violence dans l’intérêt du service et non par volonté de le sanctionner.
L’établissement doit informer la victime de la possibilité de bénéficier d’une protection fonctionnelle, afin de lui garantir une prise en charge partielle ou totale des frais d’avocat, de sa prise en charge médicale, son accompagnement psychologique et administratif … Cette protection vaut également pour les étudiants salariés dans un établissement hospitalier. Elle est accordée par l’autorité compétente qui est souvent le directeur de l’établissement de santé à la demande de la victime ou à l’initiative de l’autorité compétente.
Néanmoins, lorsque la victime soutient avoir fait l’objet d’une agression verbale et physique de la part du directeur de l’établissement, dans le cadre de son service, le principe de l’impartialité interdit à ce dernier de statuer sur la protection fonctionnelle, quand bien même il serait en principe l’autorité compétente pour statuer (CE, 29 juin 2020, n°423996). Cela permet de protéger la victime présumée contre les représailles (article L133-3 CGFP). Dans ce cas de figure, c’est le directeur de l’agence régional de santé (DGARS) qui doit être sollicité.
Il incombe au directeur général de l’établissement de mener les enquêtes nécessaires à la suite d’un signalement. Ces enquêtes permettent d’apporter des éléments supplémentaires ou de se baser sur ceux fournis par l’auteur du signalement.
II. Les sanctions
Les violences sexistes et sexuelles commises dans un établissement de santé exposent leur auteur à des sanctions de différentes natures. Ces sanctions peuvent être disciplinaires, ordinales ou pénales, selon le statut de l’agent.
- Pour le personnel non médical, deux voies sont possibles : la procédure pénale engagée devant les juridictions pénales et la procédure disciplinaire engagé par le directeur. Ces deux procédures sont indépendantes, et l’issue de l’une n’affecte pas nécessairement l’autre. Il peut également y avoir une procédure ordinale pour les personnels disposant d’un ordre professionnel.
- Pour le personnel médical, trois recours sont possibles : la procédure disciplinaire interne à l’établissement, la procédure ordinale devant le conseil de l’ordre, et la procédure pénale. La procédure disciplinaire de l’établissement et celle de l’ordre sont également indépendantes.
A. Les sanctions dans le cadre disciplinaire
Le titulaire du pouvoir disciplinaire ou ordinal doit procéder à une appréciation du caractère fautif du comportement de l’auteur de l’acte signalé afin d’engager les poursuites disciplinaires (art L532-1 CGFP). L’appréciation de la sanction disciplinaire est réalisée sous le contrôle du juge administratif. La sanction choisie doit être proportionnée à la gravité des manquements constatés.
Il est important de noter que les procédure disciplinaire et ordinale peuvent être engagées sans attendre l’issue de la procédure pénale, ces procédures étant totalement indépendantes.
Lorsqu’une procédure disciplinaire est ouverte, l’agent mis en cause ne pourra pas bénéficier de la protection fonctionnelle (CAA de Bordeaux, 09/05/2017, n°15BX01768).
Les sanctions disciplinaires des personnels non médicaux (tableau récapitulatif)
| TITULAIRE | STAGIAIRE | CONTRACTUEL |
| Art. L533-1 CGFP | Article 16 décret n°97-487 du 12 mai 1997 | Article 39 du décret n°91-155 du 6 février 1991 |
| 1er groupe Avertissement, blâme, exclusion temporaire de fonction pour une durée maximale de 3 jours | Avertissement | Avertissement |
| 2e groupe Radiation du tableau d'avancement, abaissement de l'échelon à l'échelon immédiatement inférieur, exclusion temporaire de 4 à 15 jours | Blâme
| Blâme
|
| 3e groupe Rétrogradation au grade immédiatement inférieur, exclusion temporaire de 16 jours à 2 ans | Exclusion temporaire pour une durée maximale de 2 mois avec retenue sur rémunération sauf supplément familial de traitement | L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours
L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre jours à six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et de quatre jours à un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée
|
4e groupe Mise à la retraite d'office, révocation | Exclusion définitive | Licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement |
Les sanctions disciplinaires des personnels médicaux (tableau récapitulatif)
Praticiens hospitaliers
| Praticiens contractuels | Assistants des hôpitaux | Praticiens attachés (article R6152-626 du CSP) | Praticiens associés (article R6152-930 du CSP) | |
| Avertissement | X | X | X | X | X |
| Blâme | X | X | X | X | X |
| Réduction d'ancienneté de services entraînant une réduction des émoluments | X | X | |||
| Exclusion temporaire de fonctions prononcée pour une durée ne pouvant excéder 6 mois et privative de toute rémunération | X | X | X | ||
| Suspension pour une durée ne pouvant excéder 6 mois, avec suppression totale ou partielle des émoluments | X | X | |||
| Mutation d'office | X | ||||
Révocation
| X | ||||
| Licenciement | X | X | X | ||
| Exclusion définitive du statut | X | ||||
| Procédure | Avertissement et blâme : directeur général (DG) du centre national de gestion (CNG), après avis du DG de l’agence nationale de santé (ARS), du directeur de l’établissement, de la CME siégeant en formation restreinte aux praticiens titulaires
Autres sanctions : décision motivée du DG du CNG après avis du conseil de discipline | Avertissement et blâme : directeur de l’établissement après avis du président de la commission médicale d’établissement (CME)
Exclusion temporaire et licenciement : directeur après vis du CME ou président du CME si pas d’avis dans les 2 mois | Avertissement et blâme : directeur après avis CME ou son président
Si pas rendu dans les 2 mois
Suspension et licenciement : directeur général de l’agence régionale de santé (DGARS) après avis de la CME et du directeur de l’établissement
| Suspensions prononcées par le directeur de l’établissement d’affectation après avis CME/CME locale ou président CME si pas d’avis dans 2 mois | Sanctions prononcées par le directeur de l’établissement d’affectation après avis CME ou président CME si pas d’avis dans les 2 mois |
Et pour les internes, docteurs juniors et faisant fonction d’interne
| Internes (article R6153-29 du CSP) | Docteurs juniors (article R6153-1-19 du CSP renvoie à l’article R6153-29) | Faisant fonction d’interne (article R6153-44 du CSP renvoie à l’article R6153-29) | |
| Avertissement | X | X | X |
| Blâme | X | X | X |
| Exclusion des fonctions pour une durée qui ne peut dépasser 5 ans | X | X | X |
B. Les sanctions dans le cadre pénal
La victime de violences sexuelles et sexistes peut également saisir le juge pénal.
Lorsqu’une injure ou une diffamation vise une personne en raison de son sexe, de son orientation sexuelle ou de son identité de genre, les sanctions sont plus sévères et les délais de prescription allongés. Ce délai, normalement de 3 mois, peut être porté à 1 an.
La gravité de l’infraction influence également le montant des amendes. Une injure ou une diffamation non publique est sanctionnée par une amende de 38 €. En revanche, si elle repose sur un critère discriminatoire, dont le sexe de la personne, elle peut entraîner une amende de 45 000 € et une peine d’un an d’emprisonnement.
L’outrage sexiste fait aussi l’objet de sanctions spécifiques. Il est puni d’une amende pouvant atteindre 1 500 €, avec un délai de prescription fixé à un an.
Dans le cas de l’exhibition sexuelle, la peine varie selon la victime. L’auteur encourt un an de prison et 15 000 € d’amende. Cependant, si les faits ont causé un préjudice à un mineur de moins de 15 ans, la sanction peut aller jusqu’à 2 ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende.
Certaines circonstances aggravantes, comme un abus d’autorité ou la vulnérabilité de la victime, alourdissent encore la peine dans le cadre du harcèlement. Dans ces cas, la sanction initiale de deux ans de prison et 30 000 € d’amende peut être portée à trois ans et 45 000 €.
Enfin, le viol constitue un crime puni de 15 ans de réclusion criminelle.
Harcèlement sexuel | Viol
| Injure ou diffamation à caractère sexuel ou sexiste | Outrage sexiste | Exhibition sexuelle | |
| AMENDE | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| EMPRISONNEMENT | Oui | Oui | Oui | Non | Oui |
| PRESCRIPTION | 6 ans | 20 ans 30 ans après la majorité de la victime si le viol est commis sur mineur | 3 mois dans le cas général et 1 an pour les faits en lien au sexe | 1 an | 6 ans |